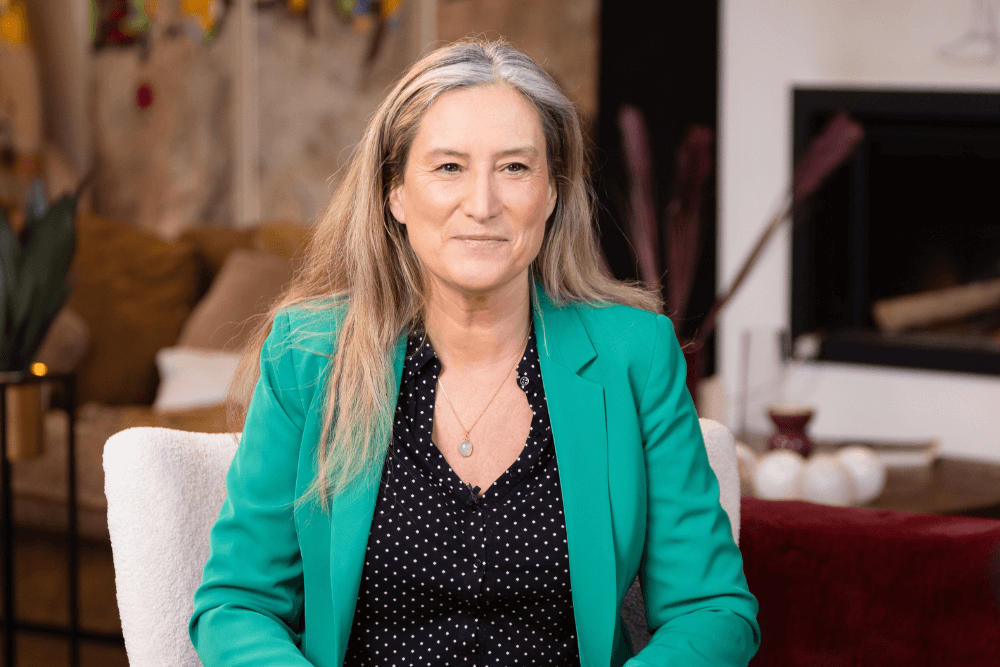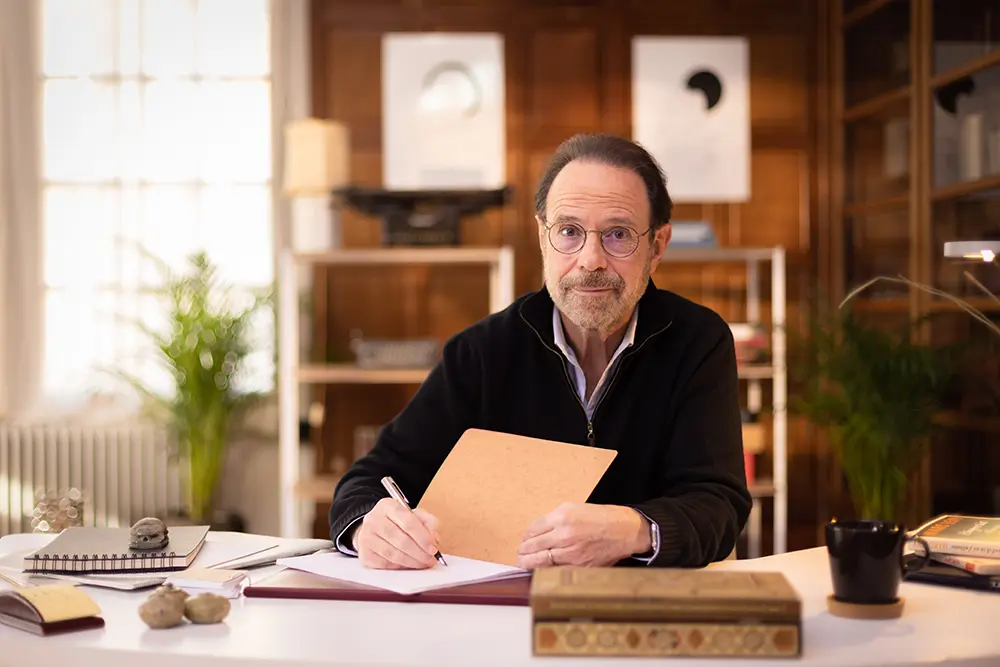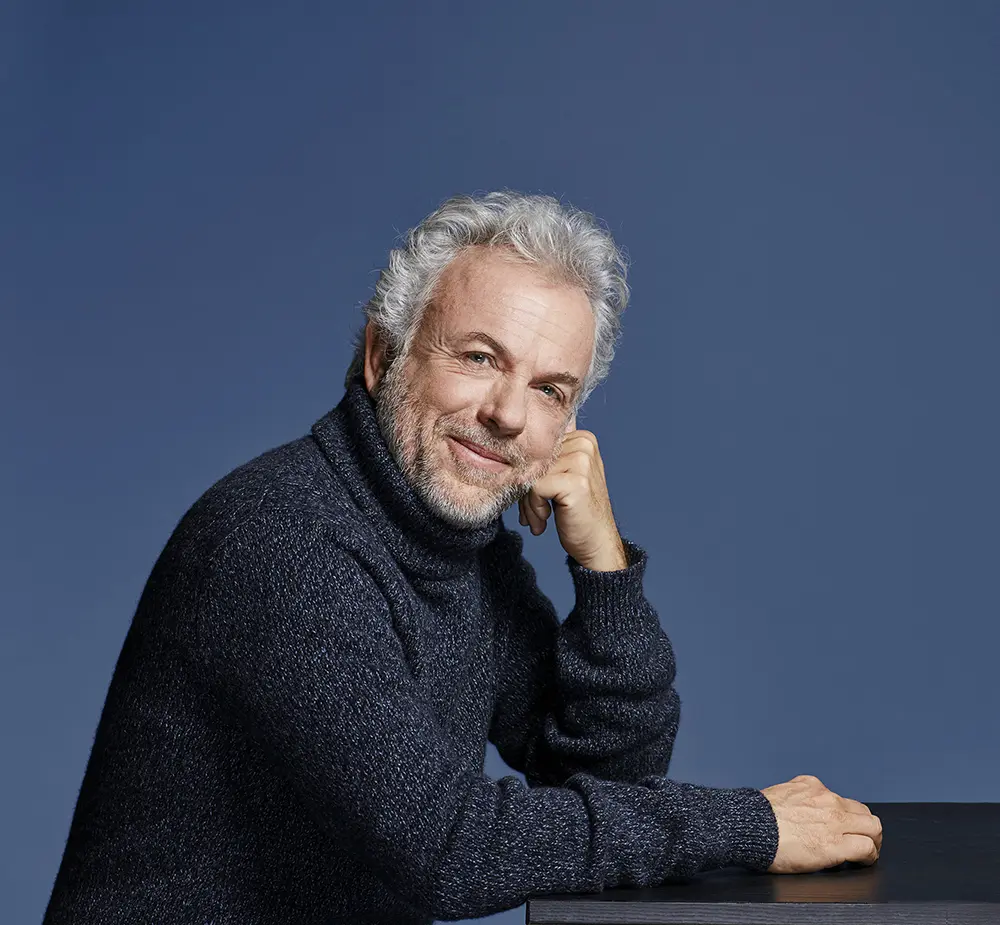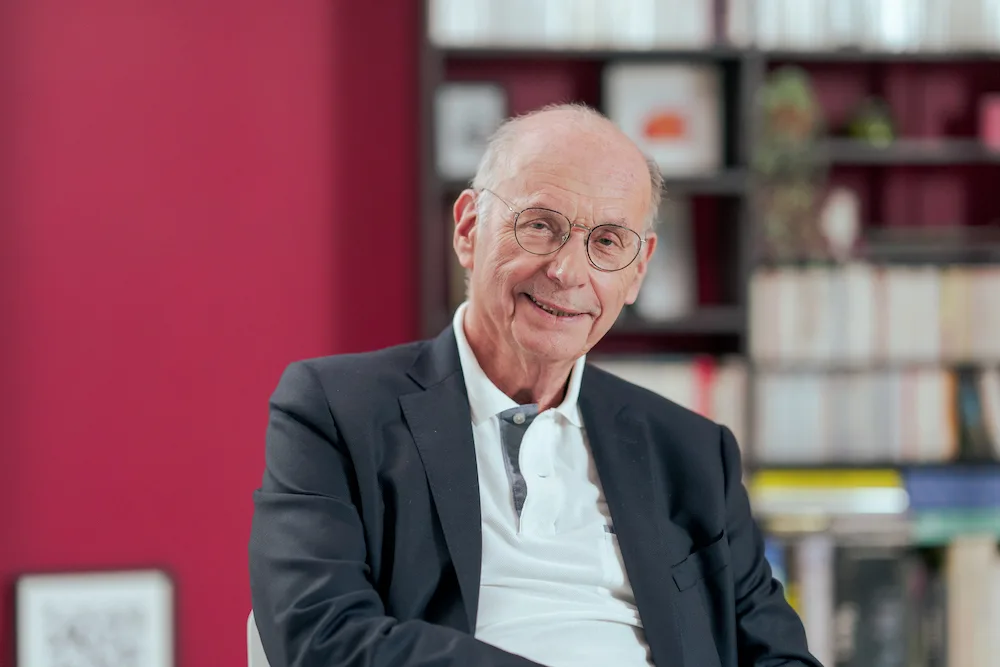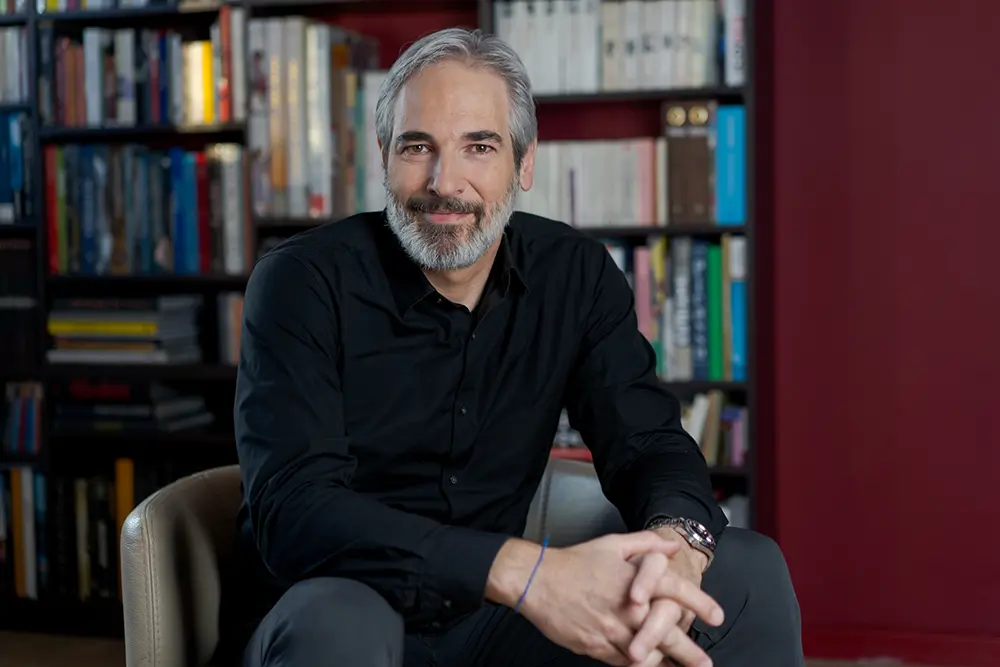En psychologie, l’effet de cadrage désigne le biais par lequel les gens réagissent différemment à une décision donnée en fonction de la manière dont elle est présentée, ou « cadrée », en mettant l’accent sur les aspects positifs (gain) ou négatifs (perte). La même information, lorsqu’elle est présentée différemment, peut modifier les réponses des gens.
Messages à retenir
- L’effet de cadrage est un biais cognitif selon lequel le choix d’un individu parmi un ensemble d’options est davantage influencé par la manière dont l’information est formulée que par l’information elle-même.
- La théorie des perspectives est essentielle pour comprendre l’effet de cadrage ; elle décrit comment les individus évaluent leurs pertes et acquièrent des connaissances de manière asymétrique. Les deux psychologues israéliens Daniel Kahneman et Amos Tversky sont responsables de l’introduction de l’effet de cadrage et de la théorie des perspectives.
- L’effet de cadrage augmente avec l’âge et a été observé dans divers contextes allant de la négociation de plaidoyer au choix d’un traitement contre le cancer. Une enquête approfondie, une approche critique et analytique de l’information et la prise en compte d’opinions diverses peuvent contribuer à éviter l’effet de cadrage.
L’effet de cadrage peut être décrit comme un biais cognitif selon lequel le choix d’un individu parmi un ensemble d’options est davantage influencé par la présentation que par la substance de l’information pertinente (Plous, 1993).
L’importance de certaines caractéristiques par rapport à d’autres, ainsi que les connotations positives ou négatives liées à l’information, sont plus susceptibles de déterminer la réponse du destinataire que l’information elle-même.
En outre, les individus sont plus susceptibles de vouloir prendre des risques lorsque l’information est présentée de manière négative, mais cherchent à éviter les risques lorsque l’information est présentée de manière positive (Tversky & Kahneman, 1981).
CHAPITRES
ToggleExemples
Voici quelques exemples où le cadrage d’une même information peut amener une personne à choisir une option plutôt qu’une autre:
- En cherchant un désinfectant, vous choisissez un produit qui tue 95 % de tous les germes (cadrage positif), plutôt qu’un produit qui affirme que 5 % des germes survivront (cadrage négatif).
- Vous êtes préoccupé par votre taux de sucre dans le sang et vous choisissez un chocolat « sans sucre à 90 % » (image positive) plutôt qu’un chocolat « avec 10 % de sucre » (image négative).
- Vous devez choisir entre deux cours facultatifs pour votre dernier semestre à l’université. Vous êtes déterminé à maintenir votre bonne moyenne et vous discutez avec le professeur de chaque cours. L’un d’eux vous dit que 20 % des étudiants obtiennent un A (cadre positif), tandis que l’autre vous dit que 80 % n’obtiennent pas de A (cadre négatif). Un médecin dit à un patient qu’une procédure a un taux de réussite de 90 % (cadre positif) contre un taux d’échec de 10 % (cadre négatif). Le patient est plus enclin à opter pour la procédure si le cadre est positif.
- Dire « Économisez 100 dollars par an en utilisant des appareils à haut rendement énergétique » (cadre de gain) plutôt que « Perdez 100 dollars par an en n’utilisant pas d’appareils à haut rendement énergétique » (cadre de perte). Le message axé sur les gains peut inciter davantage de personnes à agir.
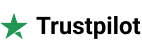


Théorie des perspectives
La théorie des perspectives est essentielle pour mieux comprendre l’effet de cadrage.
La théorie des perspectives, élaborée à l’origine par Amos Tversky et Daniel Kahneman en 1979, est une théorie psychologique du choix (Kahneman & Tversky, 1979).
Elle décrit la manière dont les personnes évaluent leurs pertes et acquièrent des connaissances de manière asymétrique. Contrairement à la théorie de l’utilité attendue, qui modélise la prise de décision d’agents parfaitement rationnels, la théorie des perspectives vise à décrire la conduite réelle des individus et trouve des applications en finance comportementale et en économie.
La théorie des perspectives soutient que les individus sont plus influencés par la possibilité d’une perte que par la perspective d’un gain équivalent (Tversky & Kahneman, 1981).
De plus, alors qu’une privation probabiliste est favorisée par rapport à une privation certaine, un gain certain est préféré à un gain probabiliste.
Ici, l’effet de cadrage devient manifeste lorsque les individus se voient proposer diverses options dans le contexte d’un seul des cadres (Druckman, 2001).
Origines de l’effet de cadrage
En 1981, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont étudié comment diverses façons de formuler la même information influençaient les réponses à une situation hypothétique de vie ou de mort (Tversky & Kahneman, 1981).
Les participants à l’étude devaient choisir entre deux options de traitement pour 600 personnes atteintes d’une maladie mortelle.
La première option était susceptible d’entraîner la mort de 400 personnes. Ces deux options ont ensuite été présentées aux participants de l’étude avec une formulation négative (décrivant le nombre de personnes qui mourraient) ou positive (décrivant le nombre de personnes qui vivraient).
Parmi les participants, 72 % ont choisi la première option de traitement lorsqu’elle était formulée de manière positive, c’est-à-dire qu’elle permettait de sauver 200 vies. Cependant, seuls 22 % ont choisi la même option lorsqu’elle était présentée de manière négative, c’est-à-dire qu’elle entraînait la mort de 400 personnes, les résultats de l’expérience ont montré que les choix que les gens font lorsqu’on leur propose des options sont influencés non seulement par la substance de l’information, mais aussi par la manière dont elle est présentée.
Expériences
Plea Bargaining
Une analyse de la littérature sur la négociation de plaidoyer a donné des résultats dévoilant l’impact du cadrage sur le système de justice pénale (Bibas, 2004). La sagesse conventionnelle veut que les parties concluent un accord sur le plaidoyer à la lumière des résultats attendus du procès.
Selon ce point de vue, à la suite d’une prévision de la peine anticipée, les parties en déduiraient la possibilité d’exonération et offriraient un rabais proportionnel.
Ce modèle conventionnel, cependant, ignore notamment les heuristiques et les biais psychologiques qui peuvent fausser le processus de prise de décision. Parmi ces biais figurent l’aversion pour les pertes, les préférences pour le risque et le cadrage, qui peuvent influencer de manière significative les résultats de la négociation.
Bien qu’un travail juridique habile puisse améliorer certains biais, les preuves suggèrent que l’impact du cadrage reste un élément crucial dans le processus.
Économistes
Une étude attirant l’attention a été menée en utilisant une expérience naturelle sur le terrain pour analyser l’effet de cadrage (Gächter, Orzen, Renner & Stamer, 2009).
Le groupe de participants à cette expérience était composé d’économistes expérimentaux, un groupe que l’on pourrait considérer comme conscient de l’effet de cadrage et, par conséquent, résistant à cet effet.
L’expérience a été menée pendant la période précédant une conférence à laquelle les participants devaient assister. Pour vérifier si la décision des participants de payer pour la conférence serait influencée par la présentation des informations sur le paiement, les participants ont été divisés en deux groupes.
Le premier groupe a présenté les informations concernant la différence entre les frais de paiement anticipé et les frais de paiement tardif dans un cadre positif, sous la forme d’un rabais. Les résultats indiquent que l’effet de cadrage a influencé les économistes expérimentaux débutants, mais pas les économistes plus expérimentés.
Les conseils peuvent-ils surmonter l’effet de cadrage ?
Une étude menée par James Druckman de l’université du Minnesota a cherché à déterminer comment les effets de cadrage peuvent être réduits ou surmontés (Druckman, 2001).
Druckman a utilisé deux expériences pour démontrer le rôle des conseils sur la manière dont les individus devraient décider lorsque diverses options sont proposées.
La première expérience a utilisé une variante de l’expérience de Kahneman et Tversky décrite ci-dessus, qui consistait à choisir un traitement hypothétique pour 600 personnes atteintes d’une maladie mortelle.
La variante ici incorporait des conseils sous forme d’approbation idéologique par le biais de l’approbation d’un parti ; alors qu’une option était le programme des Républicains, l’autre était le programme des Démocrates.
La deuxième expérience présentait aux participants un choix hypothétique entre la chirurgie et la radiothérapie pour traiter un cancer du poumon, ainsi qu’une recommandation de spécialistes de deux organisations de recherche médicale de premier plan sur l’option à choisir.
En d’autres termes, lorsqu’un républicain ou un démocrate se rend compte qu’une option a été approuvée par son parti, la manière dont l’option a été formulée n’a pas autant d’importance.
De même, lorsqu’un spécialiste recommande une option plutôt qu’une autre, la formulation des choix ne peut pas influencer de manière significative la prise de décision du participant.
L’effet de cadrage dans une langue étrangère
Une étude notable qui a analysé l’effet de cadrage dans une langue étrangère a produit des résultats intéressants (Keysar, Hayakawa & An, 2012).
Une approche purement intuitive pourrait suggérer que l’effet de cadrage reste constant malgré la langue ou peut-être que la difficulté associée à une langue étrangère peut, en fait, amplifier l’effet de cadrage parce que les défis de compréhension pourraient rendre le processus de prise de décision moins systématique.
Toutefois, la recherche démontre que l’utilisation d’une langue étrangère réduit en fait les biais de prise de décision. Les résultats de quatre expériences ont montré que lorsque diverses options de choix étaient présentées aux participants dans leur langue maternelle, ils recherchaient le risque pour les pertes et l’aversion au risque pour les gains.
Cependant, lorsque les mêmes options étaient proposées dans une langue étrangère, les participants étaient immunisés contre cette manipulation de cadrage. Ce résultat suggère que l’effet de cadrage disparaît lorsque les choix sont présentés dans une langue étrangère.
Deux expériences supplémentaires ont démontré que l’utilisation d’une langue étrangère pouvait augmenter l’acceptation de paris réels et hypothétiques avec une valeur attendue positive en réduisant l’aversion pour les pertes. La plus grande distance émotionnelle et cognitive offerte par une langue étrangère semble expliquer ces résultats.
L’âge et l’effet de cadrage
L’enfance
L’impact du cadrage sur les processus décisionnels des enfants semble augmenter au fur et à mesure qu’ils grandissent (Reyna & Farley, 2006).
Par exemple, alors que les enfants d’âge préscolaire ont tendance à fonder leurs décisions sur des propriétés quantitatives telles que la probabilité d’un certain résultat, les enfants d’âge élémentaire ont tendance à s’appuyer sur un raisonnement qualitatif, choisissant des options plus sûres pour les gains dans un cadre positif et des options plus risquées dans un cadre négatif, nonobstant la probabilité.
Cette augmentation du raisonnement qualitatif est associée à une augmentation de la pensée « basée sur l’essentiel », qui est corrélée à l’âge (Reyna, 2008).
Adolescence
Si les adolescents sont plus susceptibles d’être influencés par l’effet de cadrage que les enfants, leur sensibilité au phénomène n’est pas aussi forte que celle des adultes (Strough, Karns & Schlosnagle, 2011).
Les adolescents ont tendance à opter pour des choix plus risqués dans les situations de cadrage de perte et de gain (Albert & Steinberg, 2011).
L’une des explications de ce résultat est que les adolescents, contrairement aux adultes, n’ont pas d’expérience réelle des répercussions négatives et, par conséquent, dépendent trop des analyses conscientes des risques et des avantages qui reposent sur les détails spécifiques associés à l’évaluation quantitative (Schlottmann & Tring, 2005).
Cela diminue l’influence de l’effet de cadrage et induit une plus grande cohérence entre les cadres positifs et négatifs.
L’âge adulte
Les adultes sont plus sensibles aux effets de cadrage que les enfants et les adolescents.
Par exemple, une étude de recherche portant sur des étudiants de premier cycle a découvert qu’ils sont plus susceptibles de manger de la viande étiquetée 75 % de viande maigre plutôt que 25 % de viande grasse (Revlin, 2012).
En outre, la recherche suggère que les étudiants de premier cycle sont plus disposés à acheter un article après avoir perdu une somme d’argent équivalente plutôt que l’article lui-même.
Parmi les adultes, cependant, les adultes plus âgés sont plus susceptibles d’être influencés par l’effet de cadrage que les jeunes adultes (Peters, Finucane, MacGregor & Slovic, 2000).
Une explication possible de ce phénomène est que, le vieillissement étant corrélé au déclin des capacités cognitives, les personnes âgées ont tendance à s’appuyer sur des moyens moins exigeants sur le plan cognitif lorsqu’elles prennent des décisions (Thomas & Millar, 2011).
En tant que telles, elles sont plus susceptibles de dépendre d’informations facilement accessibles, voire de cadres. Par exemple, la recherche montre que la prise de décision des personnes âgées sur des questions médicales est davantage influencée par la manière dont les médecins encadrent les options disponibles que par la différence réelle entre ces options.
En outre, lorsqu’elles choisissent des traitements contre le cancer, l’encadrement peut faire passer leur attention de la survie à court terme à la survie à long terme (Erber, 2013).
La recherche indique également que lorsqu’on leur présente un traitement particulier, les personnes âgées sont plus susceptibles de choisir ce traitement s’il est décrit de manière positive que s’il est décrit de manière négative ou neutre (Peters, Finucane, MacGregor & Slovic, 2000).
En outre, une évaluation de la capacité des personnes âgées à se souvenir des informations contenues dans des brochures sur les soins de santé montre que les personnes âgées ont tendance à se souvenir plus précisément des déclarations formulées positivement que de celles formulées négativement (Löckenhoff, 2011).
Comment éviter l’effet de cadrage
La discussion ci-dessus, qui dévoile le fonctionnement de l’effet de cadrage, nous indique également comment il peut être évité. Voici quelques approches que nous pouvons concevoir pour prendre des décisions dépourvues de préjugés:
- Examinez attentivement les informations contenues dans les publicités et distinguez les détails bruts des embellissements séduisants utilisés pour attirer les consommateurs.
- Lorsqu’on vous présente un fait à connotation négative ou positive, essayez de le reformuler mentalement pour produire la connotation contraire avant de prendre une décision.
- Avant de choisir parmi une variété d’options, recherchez et obtenez autant d’informations que possible sur chaque option à partir d’un large éventail de sources, en recherchant à la fois des évaluations critiques et amicales de chaque option.
- Lorsqu’un certain candidat politique est diabolisé par certains médias, recherchez d’autres opinions sur le candidat auprès de ceux qui le soutiennent activement avant de vous faire une opinion sur le candidat.
Références
Albert, D., et Steinberg, L. (2011). Jugement et prise de décision à l’adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21 (1), 211-224.
Bibas, S. (2004). Plea bargaining outside the shadow of trial. Harvard Law Review, 2463-2547.
Druckman, J. N. (2001). Evaluating framing effects. Journal of economic psychology, 22 (1), 91-101.
Druckman, J. N. (2001). Using credible advice to overcome framing effects. Journal of Law, Economics, and Organization, 17 (1), 62-82.
Erber, J. T. (2012). Vieillissement et âge adulte . John Wiley & Sons.
Gächter, S., Orzen, H., Renner, E., & Starmer, C. (2009). Les économistes expérimentaux sont-ils enclins aux effets de cadrage ? A natural field experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 70 (3), 443-446.
Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory : An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of financial decision making : Part I (pp. 99-127).
Keysar, B., Hayakawa, S. L., & An, S. G. (2012). The foreign-language effect : Penser dans une langue étrangère réduit les biais de décision. Science psychologique, 23 (6), 661-668.
Löckenhoff, C. E. (2011). L’âge, le temps et la prise de décision : de la vitesse de traitement aux horizons temporels globaux. Annales de l’Académie des sciences de New York, 1235, 44.
Peters, E., Finucane, M. L., MacGregor, D. G., & Slovic, P. (2000). The bearable lightness of aging : Judgment and decision processes in older adults. The aging mind : Opportunities in cognitive research, 144-165.
Plous, S. (1993). La psychologie du jugement et de la prise de décision. Mcgraw-Hill Book Company.
Revlin, R. (2012). Cognition : Théorie et pratique. Macmillan.
Reyna, V. F. (2008). Une théorie de la décision médicale et de la santé : la théorie des traces floues. Medical decision making, 28 (6), 850-865.
Reyna, V. F., & Farley, F. (2006). Risque et rationalité dans la prise de décision des adolescents : Implications pour la théorie, la pratique et la politique publique. Psychological science in the public interest, 7 (1), 1-44.
Schlottmann, A., & Tring, J. (2005). Comment les enfants raisonnent sur les gains et les pertes : Framing effects in judgement and choice. Journal suisse de psychologie, 64 (3), 153-171.
Strough, J., Karns, T. E., & Schlosnagle, L. (2011). L’heuristique de prise de décision et les biais à travers la durée de vie. Annales de l’Académie des sciences de New York, 1235, 57.
Thomas, A. K., & Millar, P. R. (2012). Réduire l’effet de cadrage chez les adultes plus âgés et plus jeunes en encourageant le traitement analytique. Journals of Gerontology Series B : Psychological Sciences and Social Sciences, 67 (2), 139-149.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). Le cadrage des décisions et la psychologie du choix. Science, 211 (4481), 453-458.
Informations complémentaires
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. science, 211(4481), 453-458.
Druckman, J. N. (2001). Evaluating framing effects. Journal of economic psychology, 22(1), 91-101.
Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory : An analysis of decision under risk. Dans Handbook of the fundamentals of financial decision making : Part I (pp. 99-127).