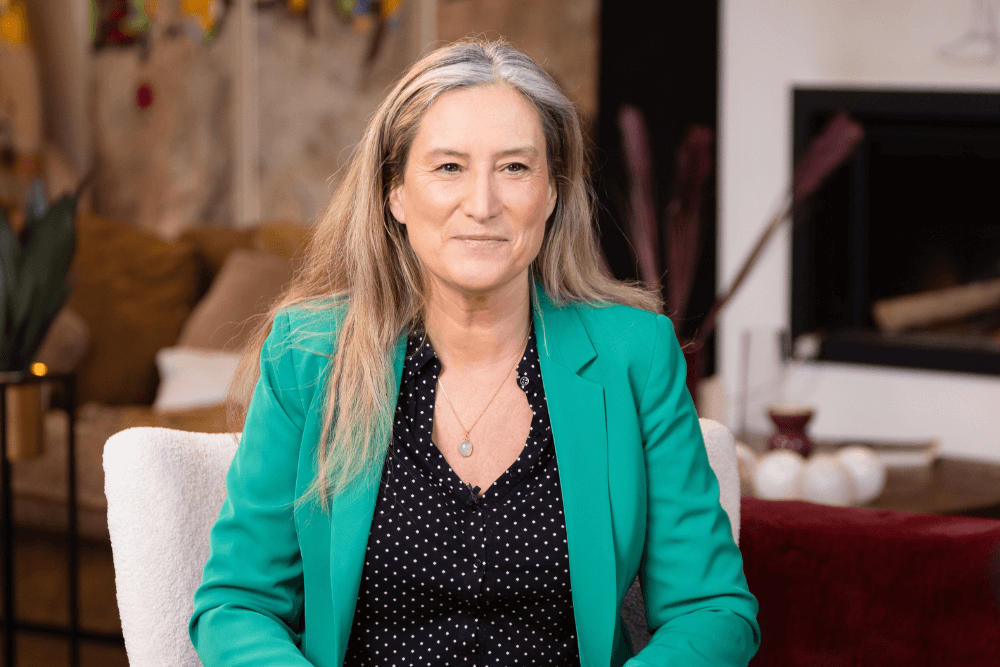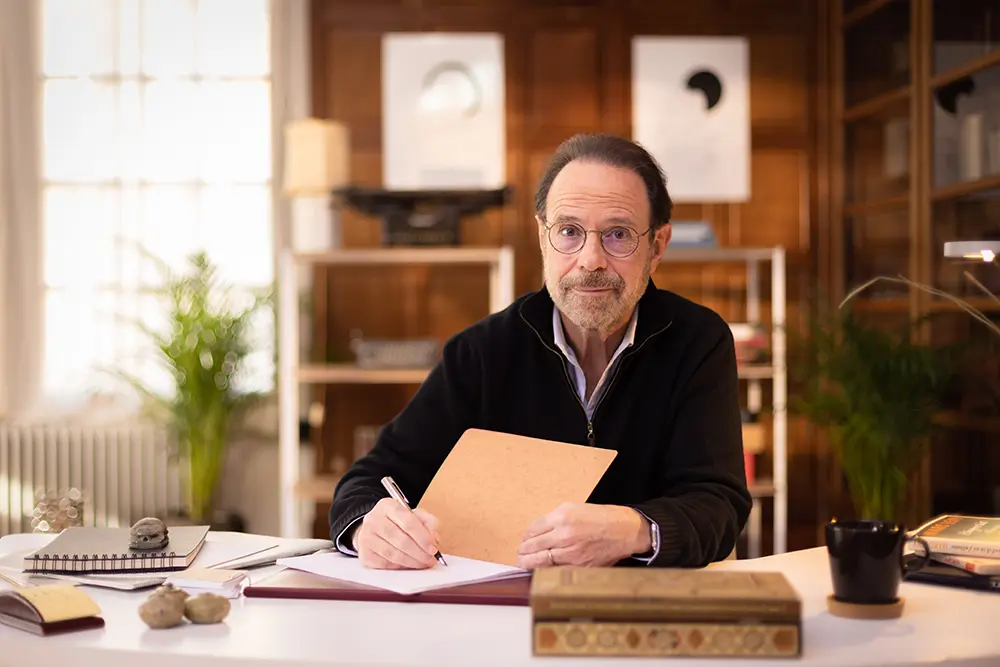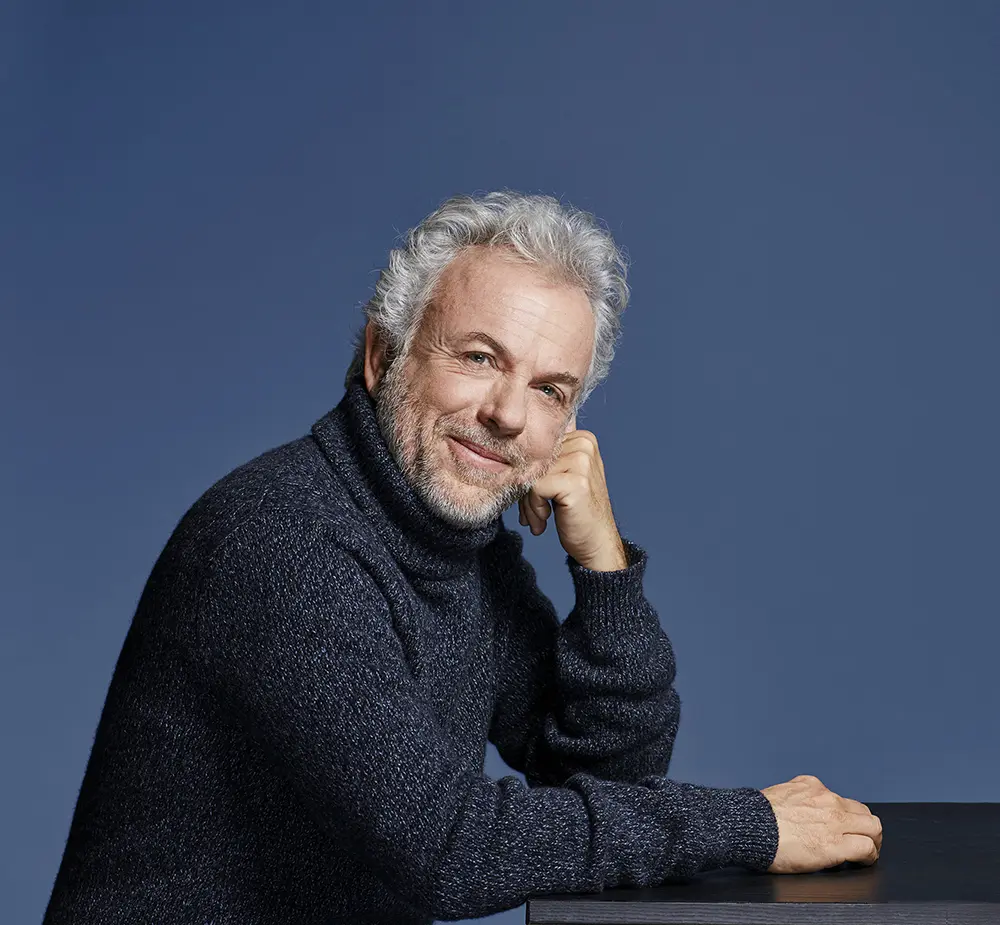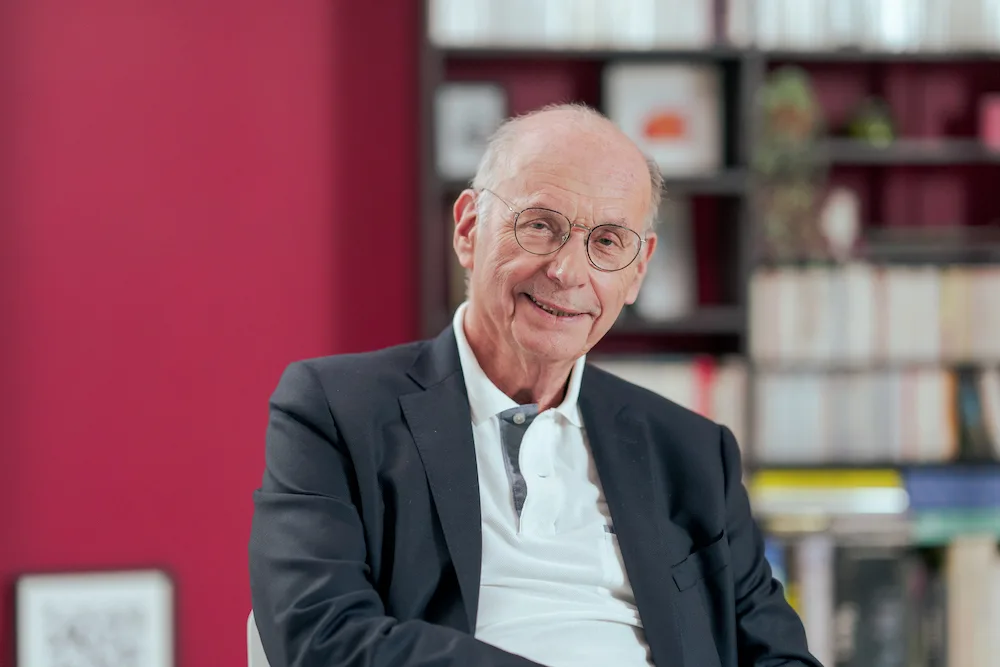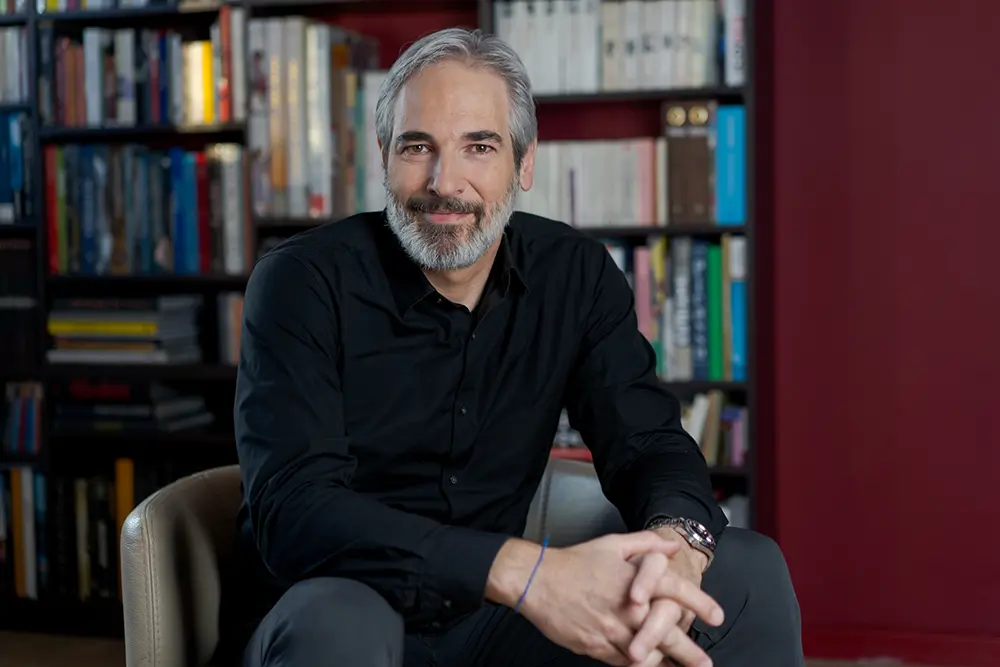Principales conclusions
- L’inégalité sociale peut créer des situations dans lesquelles les gens ressentent une tension (ou une tension) entre les objectifs que la société leur demande d’atteindre (comme la réussite financière) et les moyens légitimes dont ils disposent pour atteindre ces objectifs.
- Selon la théorie de la tension de Merton, les structures sociétales peuvent pousser les individus à commettre des crimes. La théorie classique de la contrainte prédit que la déviance est susceptible de se produire lorsqu’il y a un décalage entre les « objectifs culturels » d’une société (tels que la richesse monétaire) et les possibilités dont disposent les individus pour les atteindre. Cette théorie prédit que diverses tensions (telles que la violence et la discrimination) créent des sentiments négatifs qui, lorsqu’il n’y a pas d’autres options viables pour y faire face, conduisent à la déviance.
- Les théories modernes de la tension ont évolué à partir d’études sur l' »anomie » ou l’absence de norme. Le sociologue français Emile Durkheim a été le premier à écrire sur l’anomie. Dans ses ouvrages, La division du travail dans la société (1893) et Le suicide (1897), Durkheim a émis l’hypothèse que les groupes et les organisations sociales sont les principaux moteurs de l’inconduite.
- Principalement, Durkheim a affirmé qu’un effondrement des normes sociétales – résultant d’une évolution sociale rapide – a fait en sorte que les institutions sociétales ne pouvaient plus réguler les individus de manière satisfaisante.

CHAPITRES
ToggleThéorie de la déviance de Merton
S’appuyant sur les travaux de Durkheim sur l’anomie, Merton (1957) a été le premier à écrire sur ce que les sociologues appellent la théorie de la contrainte. Pour Merton, l’anomie est une condition qui existe dans l’écart entre les objectifs de la société et les moyens dont disposent les individus pour les atteindre.
Implicitement, l’approche de Robert Merton est que les facteurs qui conduisent à l’ordre et au désordre dans une société (comme la criminalité par rapport à l’ordre des normes sociales) ne s’excluent pas mutuellement et que les valeurs culturelles qui ont des fonctions souhaitables contiennent ou produisent souvent des conséquences indésirables (Hagen & Daigle, 2018).
Cinq réponses à la contrainte
« L’accent extrême mis sur l’accumulation de richesses comme symbole de réussite dans notre propre société milite contre le contrôle totalement efficace des modes d’acquisition d’une fortune réglementés par les institutions. La fraude, la corruption, le vice, le crime, bref tout le catalogue des comportements proscrits devient de plus en plus courant… » (Merton, 1938, p.59).
L’accent mis par la société sur la réussite financière et le matérialisme à travers la mythologie du « rêve américain » peut être stressant pour ceux dont les chances de réaliser ces rêves sont limitées (Messner & Rosenfeld, 2012).
Les récompenses de la conformité ne sont accessibles qu’à ceux qui peuvent poursuivre des objectifs approuvés à travers des moyens approuvés. Toute autre combinaison de moyens et d’objectifs est déviante d’une manière ou d’une autre.
Merton a fait valoir que les individus au bas de l’échelle sociale pouvaient répondre à cette pression de plusieurs manières. Différentes orientations vers les objectifs de la société et un accès différencié aux moyens d’atteindre ces objectifs se combinent pour créer différentes catégories de déviance.
Conformisme : les individus suivent un objectif sociétal par des moyens légitimes. Bien qu’un conformiste n’atteigne pas nécessairement l’objectif sociétal, il a suffisamment confiance en la société pour suivre des moyens légitimes.
Par exemple, un étudiant qui va à l’école pour progresser dans sa carrière professionnelle est conforme, car il suit la valeur culturelle américaine de la réussite par un moyen approuvé (Inderbitzen, Bates, & Gainey 2016).
Innovation : l’individu partage l’objectif culturel de la société, mais l’atteint par des moyens illégitimes. Les voleurs – qui partagent l’objectif culturel d’obtenir des richesses mais y parviennent en enfreignant la loi (comme le trafic de drogue ou le détournement de fonds), sont des innovateurs.
Ritualistes : individus qui ont perdu tout espoir d’atteindre les objectifs approuvés par la société, mais qui continuent de fonctionner selon les moyens approuvés par la société. Un membre de l’encadrement intermédiaire, par exemple, qui accepte qu’il ne progressera jamais mais reste à son poste est un ritualiste.
Retraités (comme les décrocheurs ou les ermites) : individus qui ont rejeté à la fois les objectifs d’une société et les moyens légitimes de les atteindre, et qui vivent complètement en dehors des normes conventionnelles.
Les toxicomanes et des personnages comme Chris McCandleless – un diplômé de l’université Emory retrouvé mort en Alaska après avoir tenté de rejeter le capitalisme, de faire du stop vers le nord et de vivre de la terre – un retrait à la fois des règles sociétales et des moyens approuvés par la société (Krakauer 2018).
La rébellion existe complètement en dehors du système de Merton. Les rebelles visent à remplacer les objectifs de la société par leurs propres objectifs et à concevoir leurs propres moyens de les atteindre.
Les exemples les plus évidents de rébellion sont les organisations terroristes, qui tentent de faire avancer un objectif, généralement politique, par des moyens tels que la violence (Inderbitzen, Bates, & Gainey 2016)
Critique de la théorie de la contrainte de Merton
La théorie de la contrainte de Merton est devenue la base d’une grande partie de la sociologie criminelle dans les années 1950 et 1960, mais elle a fait l’objet de critiques substantielles et dommageables.
Les preuves directes de la théorie de la contrainte de Merton, bien que peu nombreuses, sont contradictoires. Certaines recherches montrent que les taux de délinquance ne sont pas particulièrement élevés chez les personnes dont l’écart entre les aspirations et les attentes est le plus grand – les personnes dont les aspirations et les attentes sont faibles ont les taux de délinquance les plus élevés.
Enfin, la théorie met l’accent sur les crimes monétaires et non sur les crimes violents, ce qui soulève une question : Si Merton a raison, pourquoi les États-Unis ont-ils des taux de crimes contre les biens inférieurs à ceux de nombreux autres pays développés ? (Hagen & Daigle, 2018).
Certains ont tenté de réviser la théorie de la souche de Merton. L’une de ces révisions introduit le concept de « privation relative » – ceux qui ont moins par rapport à ceux qui les entourent ont des taux de criminalité plus élevés.
D’autres ont fait valoir que les adolescents poursuivent une variété d’objectifs non monétaires, tels que la popularité, les notes, les prouesses sportives et les relations positives avec les parents (Agnew et al…, 1996 ; Cullen et Agnew, 2003 ; Hagen et Daigle, 2018).
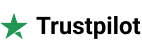


Théorie générale de la contrainte d’Agnew
La base de la théorie générale de la contrainte est que les individus qui subissent un stress ou des facteurs de stress sont souvent contrariés et font parfois face à la criminalité (Agnew et Brezina, 2019).
Selon la théorie générale de la contrainte, la contrainte augmente la criminalité parce qu’elle entraîne des émotions négatives telles que la colère, la frustration, la dépression et la peur.
Les individus veulent faire quelque chose pour corriger ces émotions, et leur situation peut faire en sorte que la perpétration d’un crime soit l’option la plus accessible pour faire face à la situation (Agnew et Brezina, 2019).
Ces émotions négatives peuvent également abaisser les barrières à la criminalité. Par exemple, les personnes en colère ont souvent un fort désir de vengeance (Agnew 2006).
Agnew (1985) soutient que la délinquance est plus fréquente chez les personnes qui vivent des événements négatifs dans leur vie, comme un divorce ou des problèmes financiers (Hagen & Daigle, 2018).
Il soutient également que la délinquance provient d’une incapacité à éviter les environnements douloureux – comme un environnement scolaire où il y a des problèmes d’interaction avec les enseignants.
Cela crée un affect négatif, et la délinquance devient un moyen d’obtenir ce que l’on a été empêché d’obtenir (instrumental), de se venger ou de s’évader (Hagen & Daigle 2018).
En conséquence, il existe trois types de contrainte, selon Agnew (Agnew & Brezina, 2019):
- La contrainte liée à la perte de quelque chose qui a de la valeur pour les personnes. Par exemple, leur argent peut être volé, un ami peut mourir ou un partenaire romantique peut les quitter.
- La tension liée au fait d’être traité de manière défavorable ou négative, comme être victime de violence verbale ou physique.
- La tension liée au fait que les personnes sont incapables d’atteindre leurs objectifs : par exemple, être incapable d’obtenir l’argent ou le respect qu’elles souhaitent.
La théorie générale de la contrainte différencie les contraintes sur deux axes différents : la contrainte objective et la contrainte subjective, ainsi que les contraintes vécues, vicariantes et anticipées.
La contrainte objective se produit en raison d’événements et de conditions que la plupart des personnes d’un groupe donné n’apprécient pas, tandis que la contrainte subjective résulte d’événements et de conditions qui ne sont pas appréciés par une personne en particulier ou par les personnes étudiées en particulier. Il s’agit d’une distinction importante, car la négativité d’une expérience peut varier radicalement d’un individu à l’autre.
Par exemple, une personne peut qualifier le divorce de pire expérience de sa vie, tandis qu’une autre peut considérer qu’il s’agit d’une cause de célébration (Agnew & Brezina, 2019 ; Agnew, 2006).
La plupart des chercheurs posent des questions sur les niveaux objectifs de tension – à savoir si les personnes ont vécu ou non des événements que les chercheurs supposent négatifs – mais il est important de considérer que certains événements dits négatifs peuvent être positifs pour certaines personnes et vice-versa (Agnew et Brezina, 2019).
Agnew (2002) fait également la différence entre la tension vécue, la tension vicariante et la tension anticipée. Les contraintes vécues sont des contraintes directement vécues par quelqu’un. Les tensions vicariantes sont des tensions subies par d’autres personnes, souvent celles envers lesquelles l’individu se sent protecteur.
Enfin, les tensions anticipées sont des tensions que les individus s’attendent à subir, en particulier dans un avenir proche.
Exemples de contraintes
Toutefois, la théorie générale des contraintes ne considère pas que les émotions négatives soient le seul facteur qui augmente la criminalité chez les personnes formées.
Les contraintes peuvent réduire les niveaux de contrôle social, comme le degré de valorisation de la conformité et la croyance que la criminalité est répréhensible.
Lorsque la tension provient d’un traitement négatif de la part des personnes en position d’autorité – comme les parents, les enseignants, les employeurs et la police – cela peut diminuer l’intérêt de l’individu pour la conformité et la société conventionnelle.
Plutôt que de se conformer aux idées traditionnelles des contrôles sociaux, les individus soumis à la tension ont tendance à adopter un système de valeurs qui minimise le souci des autres et donne la priorité à l’intérêt personnel (Agnew & Brezina 2019 ; Brezina & Agnew 2017 ; Konty, 2005).
La tension peut également encourager l’apprentissage social de la criminalité. Un élève victime d’intimidation peut être régulièrement exposé à des modèles d’agression, et les personnes ayant un emploi chronique qui vivent dans des communautés où il y a peu de possibilités économiques peuvent appartenir à des groupes qui croient que le vol et le trafic de drogue sont acceptables.
Les tensions les plus susceptibles d’entraîner la criminalité sont celles qui sont d’une grande ampleur, qui sont perçues comme injustes, les tensions associées à un faible contrôle social – comme le rejet parental – et les tensions qui créent une pression ou une incitation à faire face à la criminalité – comme un besoin désespéré d’argent (Agnew & Brezina, 2019).
De nombreux sociologues ont étudié les tensions qui sont les plus susceptibles de causer la criminalité (comme Arter, 2008, Baron & Hartnagel, 1997, et Ellwanger, 2007), et Agnew (2002) dresse une liste de ces tensions:
- Familial : rejet parental, maltraitance et négligence des enfants, problèmes conjugaux, recours à l’humiliation, aux menaces, aux cris et aux punitions corporelles.
- Scolaire : mauvaises notes, relations négatives entre élèves et professeurs, brimades et autres relations abusives avec les pairs.
- Économique : Travail impliquant des tâches désagréables, peu d’autonomie, un faible salaire, peu de prestige et des possibilités d’avancement limitées ; chômage ; sans-abrisme (qui combine un besoin désespéré d’argent avec des conflits fréquents et une victimisation criminelle) ; résidence dans des zones urbaines pauvres.
- Etre la victime d’un crime
- Discrimination basée sur des facteurs tels que la race, le sexe et la religion
Certains sociologues, comme De Coster et Kort Butler (2006), ont constaté que les tensions dans certains domaines de la vie – tels que la famille, l’école et les groupes de pairs – sont particulièrement liées à la délinquance dans ce domaine (Agnew & Brezina, 2019).
Langton (2007) a constaté que la théorie générale des tensions est capable d’expliquer certains types de « crimes en col blanc » de la classe supérieure (tels que la fraude fiscale), mais que la théorie d’Agnew ne peut pas se généraliser à tous les crimes d’entreprise.
Tous les individus ne réagissent pas au stress par des crimes.
Par exemple, quelqu’un peut faire face à la vie dans une zone urbaine pauvre en déménageant, à un manque de ressources financières en empruntant de l’argent, ou à de mauvaises notes en étudiant de manière plus efficace.
Néanmoins, la théorie générale de la contrainte décrit quelques facteurs qui rendent l’adaptation criminelle plus probable (Agnew & Brezina 2019):
- Pauvres compétences d’adaptation conventionnelles.
- Ressources pour commettre des crimes, telles que la force physique et la capacité de se battre
- Peu de soutien financier et émotionnel et d’aide directe pour s’adapter.
- Peu de contrôle de la part de la société, peu de croyance en la conformité.
- Pairs criminels. Des croyances qui favorisent l’adaptation criminelle.
- Des émotions négatives et une faible contrainte.
- Des situations où les coûts de la criminalité sont faibles et les avantages élevés.
Théorie de l’anomie institutionnelle
Steven Messner et Richard Rosenfeld, dans leur livre Crime and the American Dream (2012), étendent la théorie de la contrainte générale d’Agnew à la » théorie de l’anomie institutionnelle « . »Selon cette théorie, la société est composée d’institutions sociales (telles que la famille, la religion et la structure économique), et les taux de criminalité sont plus élevés lorsqu’une institution – la structure économique – l’emporte sur toutes les autres.
Exemples
Bullying and Self-Harm in Adolescents
Hay & Meldrum (2010) ont examiné l’automutilation chez 426 adolescents dans les zones rurales des États-Unis du point de vue de la théorie de la contrainte générale d’Agnew.
Ils ont mis l’accent sur deux aspects de la contrainte et de la déviance dont on parle rarement : l’automutilation en tant que déviance et les brimades en tant que contrainte. Selon Hay et Meldrum, l’automutilation est un acte déviant intériorisé (puisqu’il n’affecte généralement que soi-même) et peut résulter de relations tendues avec les pairs (comme les brimades).
Hay et Meldrum ont émis trois hypothèses. Premièrement, les brimades sont associées de manière significative et positive à l’automutilation. Deuxièmement, cette automutilation est influencée par les expériences émotionnelles négatives des victimes de brimades, telles que l’anxiété, la dépression et le manque d’estime de soi.
Troisièmement, un comportement parental prosocial et autoritaire et des niveaux élevés de maîtrise de soi seraient associés à des niveaux moindres d’automutilation. Hay et Meldrum considèrent que l’autorité parentale est une « variable modératrice » car elle indique un accès élevé au soutien familial.
En fin de compte, les chercheurs ont constaté que la théorie générale de la contrainte correspondait au comportement qu’ils avaient observé. Ces émotions négatives étaient particulièrement élevées chez les femmes, les personnes de couleur, celles vivant dans des ménages d’immigrants ou non intacts, et celles ayant une faible maîtrise d’elles-mêmes.
En outre, ceux qui avaient plus d’émotions négatives mais peu de possibilités de les « médiatiser » (comme par un soutien familial fort et prosocial) avaient des niveaux plus élevés d’automutilation (Hay & Meldrum, 2010).
Terrorisme
De nombreux chercheurs ont tenté de créer des théories du terrorisme en tenant compte de types particuliers de contraintes – comme la pauvreté – mais ils prennent en compte tous les facteurs susceptibles de conduire au terrorisme (Inderbitzen, Bates, & Gainey, 2016).
Le terrorisme est susceptible de résulter d’un groupe ou d’un collectif subissant des « tensions collectives » (Inderbitzen, Bates et Gainey, 2016). Ces tensions peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que la race et l’ethnicité, la religion, la classe, la politique ou les groupes territoriaux.
Toutefois, les tensions qui aboutissent le plus souvent au terrorisme sont de grande ampleur avec des victimes civiles, injustes ou causées par d’autres personnes plus puissantes (Agnew 1992).
Par exemple, des études de cas d’organisations terroristes telles que les Tigres tamouls, la Patrie et la Liberté basques, le Parti des travailleurs du Kurdistan et l’Armée républicaine irlandaise révèlent que les tensions auxquelles ces groupes ont été confrontés impliquaient des violences graves – telles que la mort et le viol – des menaces sur les moyens de subsistance, des emprisonnements et des détentions à grande échelle, et des tentatives d’éradication de l’identité ethnique (Inderbitzen, Bates, & Gainey, 2016).
Ces souches se sont produites sur de longues périodes et ont affecté de nombreuses personnes, en grande partie des civils (Callaway et Harrelson-Stephens 2006, Inderbitzen, Bates, & Gainey 2016).
Les membres de groupes terroristes qui ne semblent pas avoir connu de souches de grande ampleur rapportent tout de même avoir vécu des souches de grande ampleur (Hoffman 2006).
Par exemple, certains terroristes de droite aux États-Unis croient en un » gouvernement d’occupation sioniste « , qui menace leurs valeurs (Blazak, 2001 ; Inderbitzen, Bates, & Gainey, 2016).
Ces souches doivent être perçues comme injustes – par exemple, si elles violent des normes ou des valeurs sociales fortement ancrées ou si elles diffèrent substantiellement de la façon dont les membres du collectif ont été traités dans le passé.
Ces tensions entraînent de fortes émotions négatives, telles que la colère, l’humiliation et le désespoir, et rendent difficile l’adaptation juridique et militaire, laissant le terrorisme comme l’une des rares options d’adaptation viables (Inderbitzen, Bates et Gainey 2016).
Ils réduisent également le contrôle social et fournissent des modèles et favorisent les croyances favorables au terrorisme (Inderbitzen, Bates, & Gainey 2016).
En conséquence, suivant la théorie générale de la contrainte, les groupes terroristes ont recours à la déviance sous la forme de violence collective.
Références
Agnew, R. (1985). Une théorie révisée de la délinquance. Social Forces, 64(1), 151-167.
Agnew, R. (2002). Experienced, vicarious, and anticipated strain : An exploratory study on physical victimization and delinquency. Justice Quarterly, 19(4), 603-632.
Agnew, R., & Brezina, T. (2019). Théorie générale de la contrainte. In M. D. Krohn, N. Hendrix, G. Penly Hall, & A. J. Lizotte (Eds.), Handbook on Crime and Deviance (pp. 145-160). Cham : Springer International Publishing.
Agnew, R., & Brezina, T. (2019). Théorie générale de la contrainte. In Handbook on crime and deviance (pp. 145-160) : Springer.
Agnew, R., Cullen, F. T., Burton Jr, V. S., Evans, T. D., & Dunaway, R. G. (1996). A new test of classic strain theory. Justice Quarterly, 13(4), 681-704.
Baron, S. W., & Hartnagel, T. F. (1997). ATTRIBUTIONS, AFFECT, AND CRIME : STREET YOUTHS « REACTIONS TO UNEMPLOYMENT. Criminology, 35(3), 409-434.
Blazak, R. (2001). Des garçons blancs aux hommes terroristes : Target recruitment of Nazi skinheads. American Behavioral Scientist, 44(6), 982-1000.
Brezina, T., & Agnew, R. (2017). Délinquance juvénile et valeurs souterraines revisitées. Délinquance et dérive revisitées, 73-97.
Callaway, R. L., & Harrelson-Stephens, J. (2006). Toward a theory of terrorism : Human security as a determinant of terrorism. Studies in conflict & terrorism, 29(8), 773-796.
Cullen, F. T., & Agnew, R. (2003). Criminological theory. Past to present.
De Coster, S., & Kort-Butler, L. (2006). How general is general strain theory ? Évaluation de la détermination et de l’indétermination dans les domaines de la vie. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43(4), 297-325.
Durkheim, E. (2000). La division du travail dans la société (1893) : Blackwell.
Durkheim, E. (2005). Suicide : A study in sociology : Routledge.
Ellwanger, S. J. (2007). Strain, attribution, and traffic delinquency among young drivers : Measuring and testing general strain theory in the context of driving. Crime & Delinquency, 53(4), 523-551.
Farnworth, M., & Leiber, M. J. (1989). Strain theory revisited : Economic goals, educational means, and delinquency. American Sociological Review, 263-274.
Hagan, F. E., & Daigle, L. E. (2018). Introduction à la criminologie : Theories, methods, and criminal behavior : Sage Publications.
Hay, C., & Meldrum, R. (2010). Bullying Victimization and Adolescent Self-Harm : Testing Hypotheses from General Strain Theory. Journal of Youth and Adolescence, 39(5), 446-459. doi:10.1007/s10964-009-9502-0
Hirschi, T., & Stark, R. (1969). Hellfire et délinquance. Social Problems, 17(2), 202-213.
Hoffman, B. (2006). Insurrection et contre-insurrection en Irak. Studies in conflict & terrorism, 29(2), 103-121.
Inderbitzin, M., Bates, K. A., & Gainey, R. R. (2018). Perspectives on deviance and social control (Perspectives sur la déviance et le contrôle social) : Sage Publications.
Johnson, R. E., & Johnson, E. E. (1979). La délinquance juvénile et ses origines : An integrated theoretical approach : CUP Archive.
Konty, M. (2005). Microanomie : les fondements cognitifs de la relation entre anomie et déviance. Criminology, 43(1), 107-132.
Kornhauser, R. R. (1978). Social sources of delinquency : An appraisal of analytic models.
Krakauer, J. (2018). Into the wild (Vol. 78) : Pan Macmillan.
Langton, L., & Piquero, N. L. (2007). La théorie générale de la tension peut-elle expliquer la criminalité en col blanc ? A preliminary investigation of the relationship between strain and select white-collar offenses. Journal of Criminal Justice, 35(1), 1-15. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2006.11.011
Ménard, K. S., & Arter, M. L. (2013). Police officer alcohol use and trauma symptoms : Associations with critical incidents, coping, and social stressors. International journal of stress management, 20(1), 37.
Merton, R.K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review 3(5), 672-682.
Merton, R.K. (1949). Social structure and anomie : revisions and extensions. In : Anshen, R.N. (Ed.), La famille : Its Functions and Destiny. Harper, New York, pp. 226-257.
Merton, R.K. (1957). Structure sociale et anomie. In : Merton, R.K. (Ed.), Théorie sociale et structure sociale. The Free Press, New York, pp. 185-214.
Merton, R.K. (1957). Continuités dans la théorie de la structure sociale et de l’anomie. In : Merton, R.K. (Ed.), Théorie sociale et structure sociale. The Free Press, New York, pp. 215-248.
Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (2012). Crime and the American dream : Cengage Learning.
Messner, S. F., Thome, H., & Rosenfeld, R. (2008). Institutions, anomie, and violent crime : Clarification et élaboration de la théorie de l’anomie institutionnelle. International Journal of Conflict and Violence (IJCV), 2(2), 163-181.
Valier, C. (2001). La détection criminelle et le poids du passé : notes critiques sur Foucault, la subjectivité et le contrôle préventif. Theoretical Criminology, 5(4), 425-443.
Lectures complémentaires
Théorie sociologique et recherche criminologique : Views from Europe and the United States
Featherstone, R., & Deflem, M. (2003). Anomie and strain : Contexte et conséquences des deux théories de Merton. Sociological inquiry, 73(4), 471-489.
Messner, S. F. (1988). Merton’s « social structure and anomie » : The road not taken. Deviant Behavior, 9(1), 33-53.
Théorie générale de la contrainte d’Agnew : Contexte, résumé et application
Théorie de la contrainte générale d’Agnew : Contexte, synopsis et application
Jang, S. J., & Rhodes, J. R. (2012). Théories générales de la contrainte et de la non contrainte : A study of crime in emerging adulthood. Journal of Criminal Justice, 40, 176-186.
Chamlin, M. B., & Cochran, J. K. (2007). An evaluation of the assumptions that underlie institutional anomie theory. Theoretical Criminology, 11(1), 39-61.
Quelle est la différence entre la théorie du stress de Merton et le stress de rôle ?
La théorie du stress de Merton traite des structures sociétales plus larges et de la déviance qui en découle, tandis que le stress de rôle se concentre sur les difficultés rencontrées pour répondre aux attentes multiples d’un rôle sociétal unique. Par exemple, une mère qui travaille peut être confrontée à une tension de rôle lorsqu’elle doit concilier ses responsabilités professionnelles et ses obligations parentales