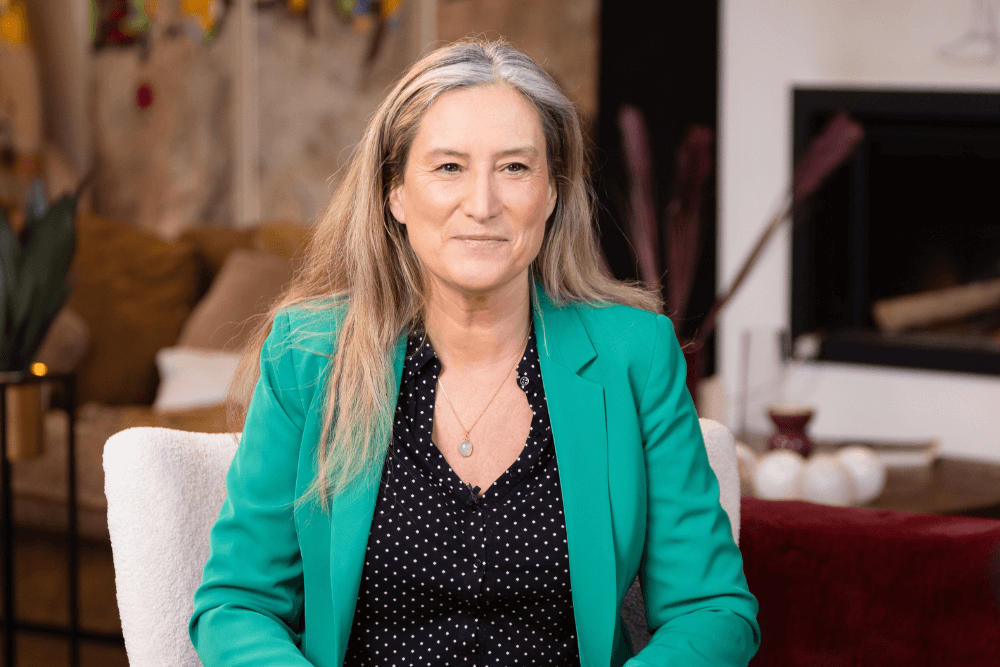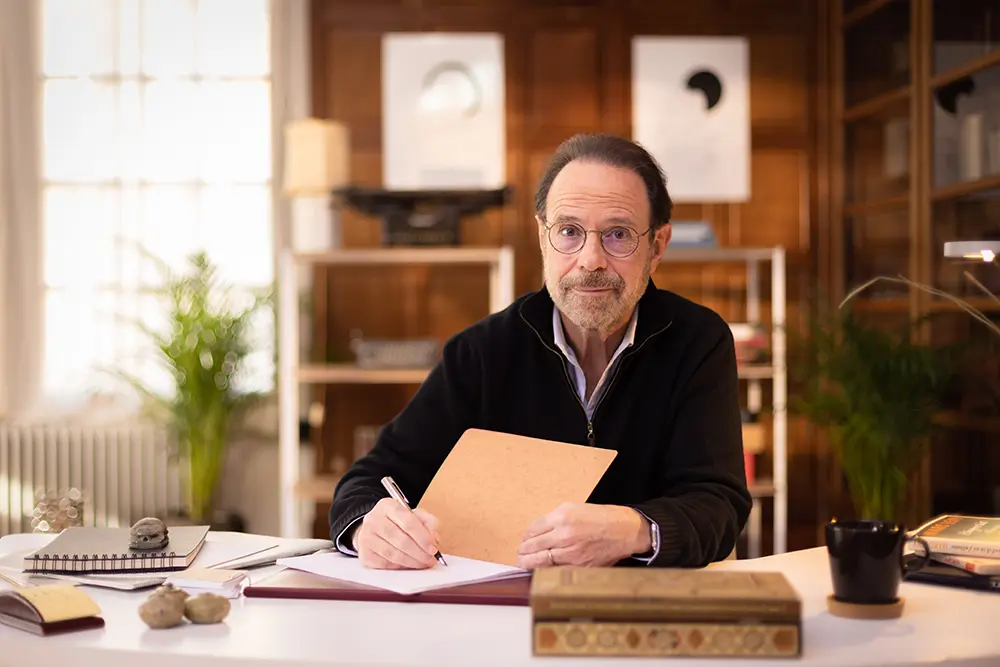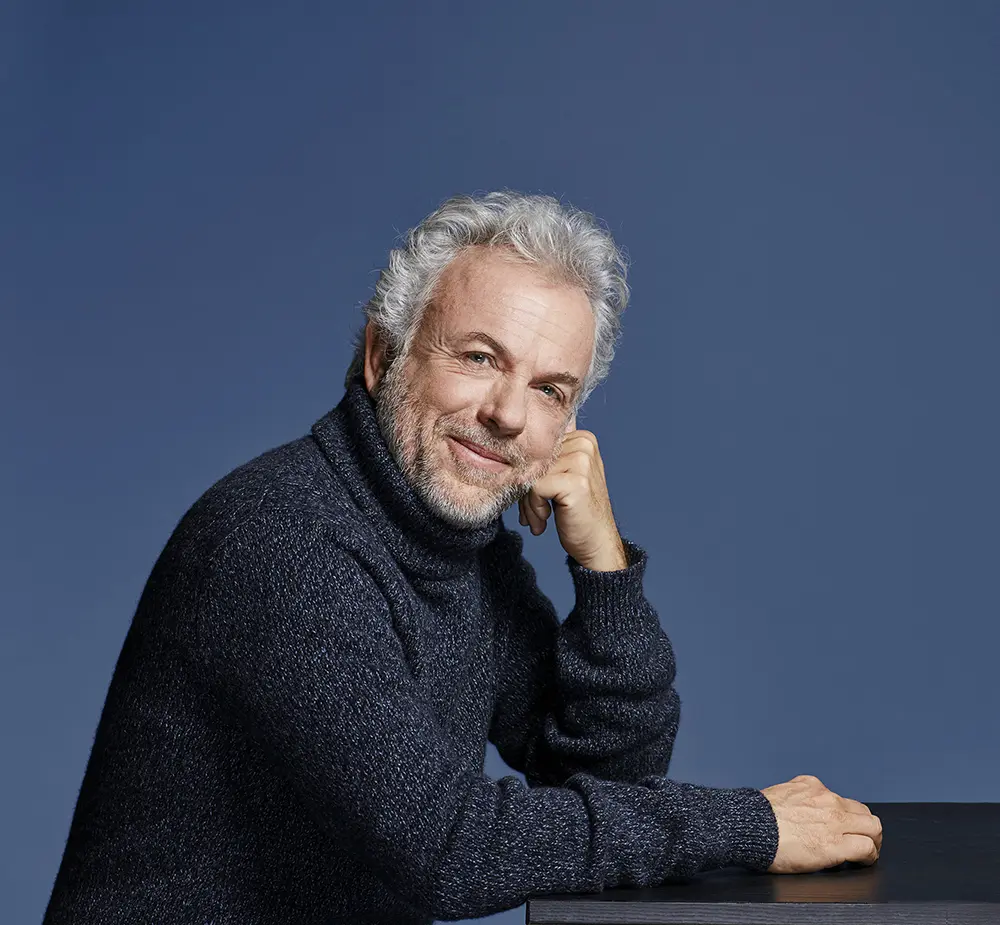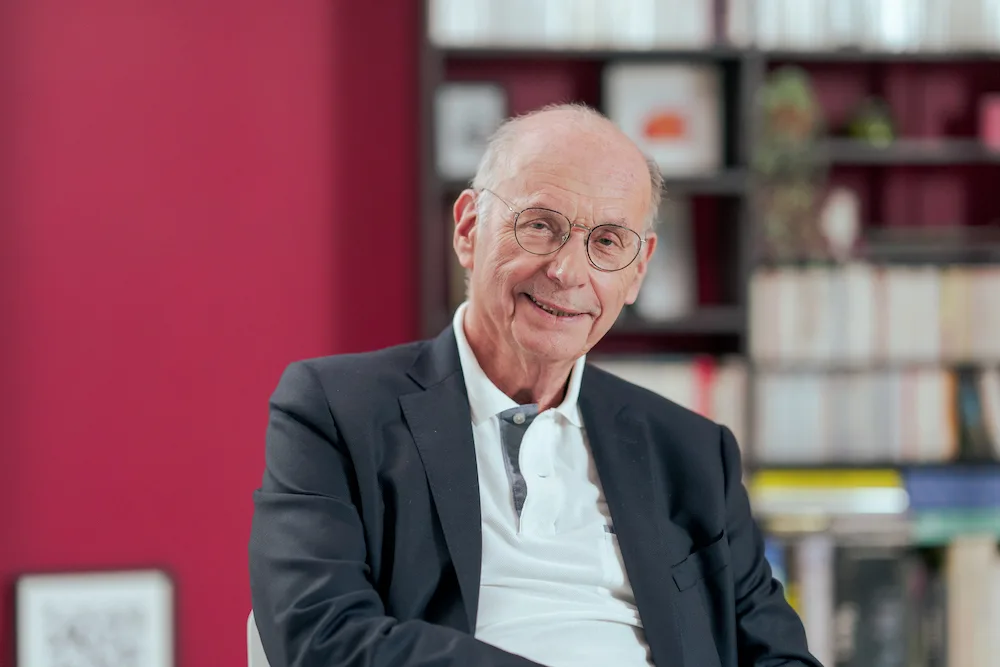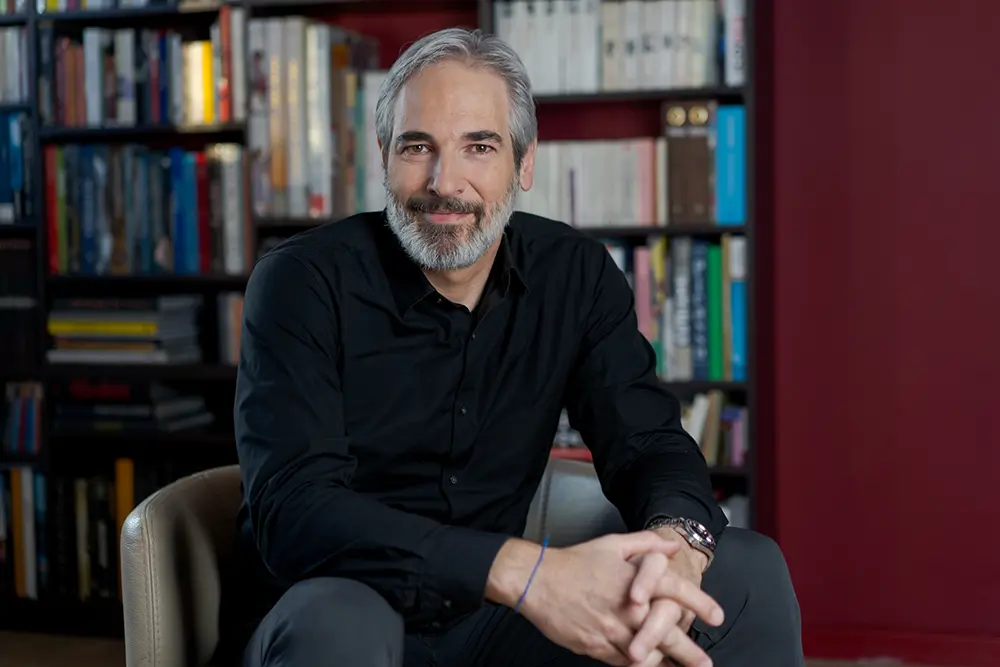Les temps incertains sont un terrain propice à la désinformation.
Il se peut que vous ayez l’impression d’avoir été inondé de théories du complot ces derniers temps.
Une enquête en ligne réalisée en mai 2020 auprès de 2 501 adultes en Angleterre a révélé que 25 % des personnes interrogées croyaient aux théories du complot du COVID-19, qui n’ont pas été prouvées.
Un sondage réalisé en janvier 2021 auprès de 1 239 électeurs américains a révélé que 77 % des répondants républicains pensent qu’il y a eu une fraude électorale généralisée, bien que les tribunaux en aient décidé autrement.
La vérité, c’est que les théories du complot n’ont rien de nouveau.
Peu après l’alunissage de 1969, des théories ont commencé à circuler selon lesquelles l’ensemble avait été mis en scène.
Mais comme nous l’avons vu lors de l’émeute au Capitole le 6 janvier, les théories du complot ne sont pas seulement des idées non prouvées (ou réfutées).
Laisser circuler des conspirations peut avoir des conséquences mortelles. Cinq personnes, dont un policier, sont mortes lorsque des insurgés ont tenté de faire un coup d’État au Capitole.
Il est naturel et compréhensible de se sentir en colère, frustré ou attristé par ces événements. Les experts nous invitent à prendre du recul et à réfléchir aux raisons pour lesquelles les gens croient aux théories du complot et à examiner nos propres vulnérabilités, en particulier en période d’incertitude.
« Lorsque les gens se sentent menacés et hors de contrôle, il est naturel de vouloir se sentir plus maître de la situation et de mettre de l’ordre dans le hasard en recourant aux théories du complot », déclare John Cook, PhD, fondateur du site Web Skeptical Science et coauteur de « The Conspiracy Theory Handbook » (Le manuel de la théorie du complot). »Cela ne signifie pas que nous devrions permettre aux théories du complot de perdurer ou que les personnes qui enfreignent la loi au nom de ces théories ne devraient pas avoir à en subir les conséquences.
Mais les experts affirment qu’en prenant du recul et en évaluant ce qui rend ces théories plausibles aux yeux de certaines personnes, nous pouvons engager un dialogue plus productif.
Nous pouvons également éviter de nous engager dans des conversations sur les théories du complot au détriment de notre santé mentale.
CHAPITRES
TogglePourquoi les gens croient-ils aux théories du complot ?
Certaines expériences de vie et certains traits de personnalité rendent les gens plus susceptibles d’adhérer à des affirmations frauduleuses.
Voici ce que les données et les experts disent des facteurs qui contribuent aux récits non prouvés ou réfutés.
Ils croient qu’ils bénéficient de la théorie du complot
Vous est-il déjà arrivé de vouloir à tout prix que quelque chose soit vrai ? Cela nous arrive à tous de temps en temps. Mais pour certaines personnes, il vaut mieux croire à un mensonge que d’affronter la réalité.
Une revue de recherche de 2017 a révélé que les personnes qui adhèrent aux théories du complot pensent qu’elles en tirent un bénéfice social et existentiel.
Par exemple, une personne peut préférer fortement qu’un certain candidat politique remporte une élection parce qu’elle pense que cette personne assurera sa sécurité physique et financière. D’autres personnes peuvent ne pas vouloir croire que le changement climatique est réel parce qu’elles travaillent ou investissent dans l’industrie du charbon.
« Ils veulent croire en leur cause et se battre pour elle même si leur esprit rationnel leur dit qu’ils n’y croient pas », explique Carla Marie Manly, PhD, psychologue clinicienne spécialisée dans la peur, les médias et l’impact psychologique de questions telles que les théories du complot sur la psyché.
« Nous avons cette mentalité tribale qui nous pousse à vouloir faire partie d’un groupe », explique M. Manly. « À un niveau très primitif, nous nous sentons en sécurité… nous avons l’impression de ne pas être seuls et de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, où les gens nous comprennent et où nous les comprenons. »
L’un des problèmes est que la croyance en une théorie du complot se retourne souvent contre la personne et lui nuit socialement et existentiellement. Les hommes politiques des deux bords ont condamné les émeutiers au Capitole, par exemple.
Malgré cela, les gens peuvent continuer à croire à la théorie.
« Pour certains, c’est une question de fierté », dit Manly. « Il y a des gens qui, jusqu’au bout, s’accrocheront à quelque chose qui n’est pas vrai parce qu’ils ne veulent pas croire qu’ils ont tort. »
Ils veulent se sentir intelligents
Posséder des informations ou des connaissances que personne d’autre n’a peut naturellement nous faire nous sentir uniques. Une étude de 2017 indique que les personnes qui croient aux théories du complot ont besoin de se sentir uniques en connaissant des « informations rares ».
« Vous verrez ce [désir] d’être supérieur », dit Manly. « Vous avez l’impression d’être au-dessus des autres, de savoir quelque chose de plus. C’est l’idée que je suis au courant et que vous n’êtes pas au courant. Cela signifie que les gens peuvent apprendre au fil du temps que le fait d’avoir ces croyances leur donne l’impression d’être importants. Cela renforce la tendance à adhérer à des croyances similaires à l’avenir.
« Un père peut avoir toujours eu besoin d’avoir raison », explique Manly. « Cet enfant apprendra de ce parent qu’il sera élevé s’il dispose de peu d’informations.
Le niveau d’éducation d’une personne peut jouer un rôle dans le fait qu’elle soit plus susceptible de croire à une théorie du complot, selon une étude de 2016. Cette étude a montré qu’un faible niveau d’éducation est corrélé à une plus grande probabilité de croire aux théories du complot.
« Idéalement, l’une des choses que nous apprenons dans l’enseignement supérieur est la pensée critique », déclare Manly.
D’un autre côté, les personnes titulaires d’un diplôme de troisième cycle croient également aux théories du complot et les propagent. Les avocats Sidney Powell et Rudy Giuliani, par exemple, ont défendu et perpétué des allégations de fraude électorale.
Cook estime que plus une personne est instruite, plus il peut être difficile de la ramener à la réalité ou même d’avoir une conversation saine avec elle sur ses croyances.
« Ce n’est pas dû à la connaissance ou à l’intelligence ; c’est dû à l’idéologie, aux croyances et à l’identité », explique-t-il. « Cela signifie que plus une personne est éduquée, plus elle acquiert de compétences lui permettant de nier plus habilement.
Ils peuvent avoir un sens moral différent
Certaines personnes estiment que participer aux efforts d’atténuation du COVID-19, comme porter un masque et limiter les contacts aux personnes de leur foyer, est une obligation morale de se protéger les uns les autres.
Certaines personnes peuvent également estimer que prendre des mesures pour enrayer le changement climatique, notamment en réduisant l’utilisation des combustibles fossiles, est également une obligation morale pour rendre le monde plus sûr pour les générations futures.
D’autre part, certaines personnes considèrent les libertés individuelles comme un impératif moral. Une étude menée en 2020 auprès de 245 Roumains a montré que les personnes qui avaient des idées de conspiration sur les mesures d’éloignement physique à prendre pour empêcher la propagation du COVID-19 faisaient preuve d’un plus grand désengagement moral et d’une plus grande intolérance à l’égard de l’incertitude.
Un fort sentiment d’individualisme a été un facteur prédictif majeur chez ceux qui ne croient pas que le COVID-19 est un problème et ne prennent pas les précautions recommandées, explique Cook.
« C’est similaire à ce que nous voyons avec le déni du climat. Par exemple, les gens veulent manger dans leur restaurant préféré sans que le gouvernement leur dise qu’ils ne peuvent pas le faire. L’étude de 2020 mentionnée ci-dessus suggère que le fait d’insister sur l’importance morale de la distanciation physique peut aider les gens à se rallier aux efforts d’atténuation.
Si quelqu’un croit que COVID-19 est un canular, cela devient plus difficile, surtout si l’on se souvient que les personnes qui font confiance aux théories du complot plutôt qu’aux faits veulent souvent se sentir intelligentes et uniques.
« Venez d’un paradigme qui dit : ‘Je me sens comme ça. Ce sont mes convictions. Je comprends vos croyances, mais lorsque nous sommes ensemble, pourriez-vous vous rapprocher un peu plus des miennes afin que je me sente en sécurité ? Je ne dis pas que vous avez tort, mais je me sens plus à l’aise si vous portez un masque » », dit Manly.
Cette approche peut donner à votre proche l’impression qu’il vous fait une faveur. S’il se soucie de vous, il sera peut-être plus enclin à changer d’avis. Par exemple, dire « Les recherches montrent que le port d’un masque aide à réduire la propagation du COVID-19 » peut mettre l’autre personne sur la défensive en lui donnant l’impression que vous essayez d’être plus malin qu’elle.
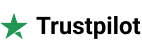


Autres façons de gérer les théories du complot dans votre vie
Les temps sont incertains, ce qui rend le monde propice à la propagation des théories du complot.
Les médias sociaux donnent également une tribune aux gens et vous rendent plus enclin à voir et à apprendre que quelqu’un que vous connaissez croit à de fausses idées. Il est tentant de vouloir corriger cette personne, surtout si vous vous souciez d’elle.
Avant de vous engager avec quelqu’un pour le convaincre que ses affirmations sont sans fondement, demandez-vous ce que vous en retirerez.
« Examinez la situation et le bénéfice que vous en tirerez », suggère M. Manly. « Peut-être souhaitez-vous rendre visite à un parent qui n’est pas d’accord avec la gravité du COVID-19, mais vous ne vous sentez pas à l’aise s’il refuse de s’asseoir à l’extérieur et de porter un masque.
Peut-être qu’une connaissance du lycée publie sur Facebook des affirmations de fraude électorale, et vous voulez au moins fournir des contre-sources crédibles au cas où quelqu’un d’autre qui pourrait avoir ces convictions passerait à côté.
Si vous avez décidé d’aller de l’avant et d’engager le dialogue avec la personne, les experts suggèrent d’adapter votre approche en fonction de la relation que vous entretenez avec la personne.
Quelle que soit votre proximité avec la personne, les experts suggèrent d’entamer la conversation en sachant que vous ne la ferez probablement pas changer d’avis.
« Une fois que les gens commencent à s’enfoncer dans le trou du lapin et à croire aux théories du complot, l’un des résultats est qu’ils développent une telle suspicion à l’égard de l’information, en particulier des sources traditionnelles, que toute information qui contredit leur théorie du complot est interprétée comme faisant partie de la théorie du complot », explique Cook.
Par exemple, les gens peuvent dire : « Les médias traditionnels voulaient que Trump perde, alors il est évident qu’ils ne parlent pas des irrégularités dans les votes. »
S’engager dans une conversation en ayant peu d’attentes peut être bénéfique pour votre santé mentale. C’est ce que fait Cook lorsqu’un négateur du changement climatique lui pose une question ou fait un commentaire lors de ses présentations.
« Je répondrai à leur question, mais je reconnais aussi mentalement qu’il est tout à fait improbable qu’ils changent d’avis », explique-t-il. « Cela vous donne un calme zen. Essayer de faire changer d’avis une personne dont on ne peut pas changer d’avis peut être frustrant et vous mettre en colère. »
S’il s’agit d’un membre de la famille ou d’un ami proche
Si vous avez déjà établi une relation de confiance avec quelqu’un, essayez de vous appuyer sur cette relation lorsque vous entamez le dialogue.
Manly suggère de dire quelque chose comme :
« Je me sens inquiet d’avoir vu ce message [ou cette implication]. Cela m’inquiète parce que _____. Si cela vous intéresse, pourquoi ne pas vous envoyer une étude que j’ai trouvée ? Nous pouvons en parler, ou vous pouvez simplement l’envisager. »
Manly aime cette approche parce qu’elle n’est pas provocatrice et laisse la balle dans le camp de l’autre personne si elle veut continuer à en discuter. Vous ne le traitez pas d' »idiot », de « fou » ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse mettre fin à la conversation. « Plus ils sont souples, plus ils sont susceptibles d’accepter une conversation à ce sujet. »
S’il s’agit d’un ami Facebook avec lequel vous ne parlez pas régulièrement
Les médias sociaux peuvent nous aider à rester en contact avec de vieux amis et de vieilles connaissances. Ils nous permettent également de connaître leurs opinions sur l’actualité et les théories du complot.
Vous avez probablement déjà fait défiler quelques messages ou vu de longs fils de discussion où les gens se disputent à bâtons rompus. Manly suggère de ne pas aller aussi loin.
« Essayer de faire changer d’avis quelqu’un, en particulier dans un forum public, ne va pas bien se passer », dit-elle. « Maintenant qu’ils sont en public, les enjeux sont plus élevés si l’on prouve qu’ils ont tort. En tant qu’êtres humains, nous avons déjà du mal à admettre nos erreurs en privé. En public, c’est plus difficile, surtout si la personne a une faible estime d’elle-même.
Manly recommande de dire : « Merci d’avoir partagé cela avec moi. Je ne suis pas d’accord à cause de XYZ. »
« Ne vous en tenez pas là », conseille-t-elle.
Quand couper les ponts
Les temps sont stressants. Un désaccord fondamental avec la famille et les amis sur le sens de la réalité peut aggraver la situation. Si les convictions d’un proche ont un impact négatif sur votre santé mentale, vous pouvez fixer des limites.
« S’il s’agit d’un sujet brûlant, vous avez le droit de dire « Je ne me sens pas à l’aise pour parler de cette question, alors pouvons-nous la mettre de côté et parler de nos projets pour l’année ? » Déclare Manly.
« Ne parlez pas d’eux, mais plutôt de « ce n’est pas sain pour moi » En vous en tenant à cela, vous travaillez sur vos propres limites et vous leur montrez, à leur insu, des limites saines », dit-elle.
S’ils dépassent les bornes, Manly dit que c’est à vous de décider combien de chances vous voulez donner. Chaque personne a ses propres limites. Vous n’êtes pas non plus obligé de leur donner la moindre chance, en particulier si leurs croyances vous causent du tort ou en causent à d’autres personnes.
« Si vous avez l’impression qu’ils ne sont pas en sécurité ou qu’ils ont franchi vos limites, vous pouvez absolument [leur couper les vivres] », déclare Mme Manly. « Nous devons tous connaître notre propre sens moral
Elle suggère de dire : « C’est tellement difficile pour moi d’accepter cela. J’ai vraiment besoin de prendre du recul par rapport à vous. »
À retenir
Les théories du complot ne datent pas d’hier, mais on peut avoir l’impression qu’elles sont omniprésentes en ce moment. Les périodes d’incertitude constituent un terrain propice à ce type de désinformation.
Les gens sont plus enclins à croire aux théories du complot s’ils pensent en tirer un avantage social ou existentiel. Même s’ils n’en bénéficient pas, leur fierté peut les empêcher de considérer d’autres perspectives.
Les personnes qui veulent se sentir uniques ou qui sont moralement désengagées dans l’atténuation d’un problème peuvent également adhérer à des affirmations non étayées, même si elles ont un niveau d’éducation élevé.
Avant de vous engager avec une personne qui croit aux théories du complot, demandez-vous si cela en vaut la peine. Si c’est le cas, adaptez votre approche en fonction du degré de connaissance que vous avez de cette personne et comprenez que vous ne la ferez probablement pas changer d’avis.
Il n’y a pas de mal à fixer des limites ou à couper les ponts avec quelqu’un si ses croyances nuisent à votre santé mentale et font que vous ou quelqu’un d’autre ne vous sentez pas en sécurité sur le plan physique ou émotionnel.
Beth Ann Mayer est une écrivaine basée à New York. Pendant son temps libre, elle s’entraîne pour des marathons et s’occupe de son fils, Peter, et de trois animaux domestiques.